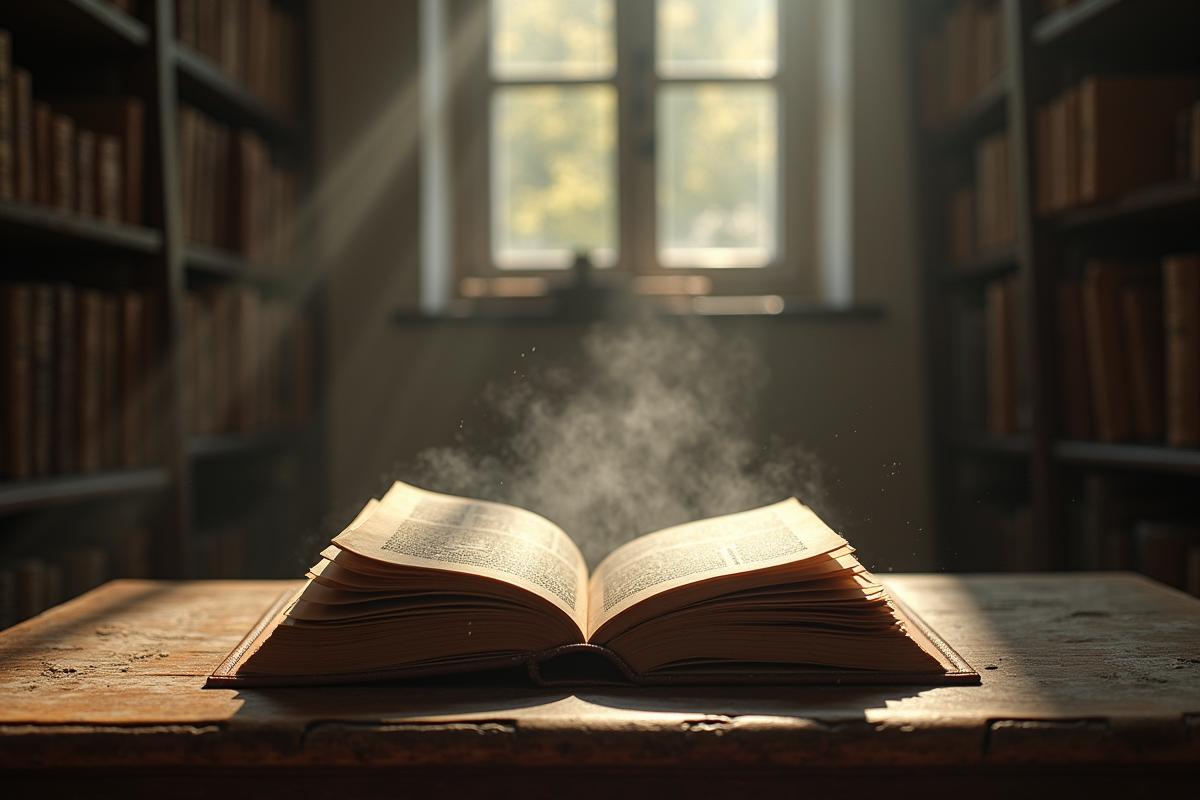Un livre imprimé avant 1850 dégage des composés organiques volatils différents de ceux d’un ouvrage contemporain. Certains laboratoires classent ces émanations comme indicateurs fiables de l’état de conservation du papier. Pourtant, la chimie derrière ce phénomène reste mal interprétée en dehors des milieux spécialisés.
La composition du papier, les procédés d’encrage et les conditions de stockage engendrent des variations notables dans la signature olfactive des ouvrages anciens. Les chercheurs identifient désormais ces marqueurs chimiques pour retracer la trajectoire matérielle et historique des livres.
Pourquoi les vieux livres sentent-ils si bon ?
L’odeur des vieux livres ne laisse personne indifférent. Ce parfum particulier, qui évoque tour à tour la vanille, le bois, la terre ou même le biscuit, puise sa source dans le vivant du papier. Les livres anciens, faits de cellulose et de lignine, relâchent au fil des ans une gamme de composés organiques volatils qui racontent leur histoire. La lignine, issue du bois, libère notamment des notes rappelant le chocolat ou le café, conférant cet arôme si spécifique aux ouvrages d’autrefois.
Les variations dans l’odeur d’un livre ancien ne doivent rien au hasard. Plusieurs facteurs entrent en jeu, chacun ajoutant sa nuance à la composition finale :
- Date de production : l’époque d’impression façonne le profil olfactif ; un livre d’avant 1850 développe des effluves bien distincts de ceux des éditions modernes.
- Stockage et humidité : l’humidité, ou un environnement mal aéré, accentue les senteurs de moisi ou de renfermé, tandis qu’un lieu sec préserve davantage les notes subtiles du papier.
- Expérience vécue du livre : chaque lecteur, chaque manipulation, imprime sa marque, modifiant peu à peu la fragrance du volume.
À la bibliothèque de la cathédrale Saint-Paul de Londres, la chercheuse Cecilia Bembibre a mené une analyse minutieuse des parfums ambiants : des notes boisées, fumées, terreuses et d’amande, échos du mobilier, de la poussière et du temps qui passe sur le papier. Parmi les molécules décelées, la vanilline rappelle la vanille, le benzaldéhyde l’amande, et le 2-ethyl hexanol apporte une touche florale. L’odeur des vieux livres devient alors bien plus qu’une curiosité : elle incarne la mémoire partagée du lieu, un lien sensoriel entre le lecteur d’aujourd’hui et l’histoire silencieuse de la bibliothèque.
À la découverte des secrets chimiques derrière l’odeur des livres anciens
Au fil des décennies, le papier des ouvrages anciens se métamorphose, libérant quantité de composés organiques volatils (COV) qui signent leur identité. La cellulose et la lignine, piliers de la structure du papier, se dégradent sous l’effet du temps, de l’humidité et des acides. Les travaux du UCL Institute pour le patrimoine durable, dirigés par Matija Strlič, ont permis d’identifier plusieurs molécules déterminantes : la vanilline, qui donne la note vanillée, le benzaldéhyde pour l’amande, et le 2-ethyl hexanol à la tonalité florale.
Dans le détail, la lignine, héritée du bois, joue un rôle moteur : elle jaunit le papier et génère des arômes évoquant le café ou le chocolat. L’hydrolyse acide favorise la libération de molécules comme l’acide propanoïque (pour les notes rances) ou l’hexanal (herbacé), des nuances particulièrement perceptibles dans les ouvrages ayant séjourné en milieu humide. Les encres et colles anciennes, elles aussi, ajoutent leur grain de sel à ce cocktail aromatique complexe.
Ainsi, chaque livre ancien révèle une carte d’identité chimique unique, reflet de son parcours, de ses conditions de conservation et des choix de fabrication de l’époque. Andy Brunning, enseignant en chimie, rappelle que ces COV composent un véritable langage moléculaire, décrypté par notre odorat mais aussi par les spécialistes de la conservation.
L’art de savourer les parfums du passé : explorer et apprécier les trésors olfactifs des bibliothèques
Respirer l’odeur d’un vieux livre dans une bibliothèque, c’est vivre une expérience sensorielle à part entière. Les salles, les rayons, chaque recoin, diffusent des parfums issus de la lente transformation du papier, de l’encre et des colles. À la cathédrale Saint-Paul, Cecilia Bembibre a mis en lumière une signature olfactive complexe : des notes boisées, fumées, terreuses, ponctuées de vanille, d’amande et parfois de moisi. Dans ce décor, la mémoire du livre et les traces de ses lecteurs se mêlent à la perception.
Le projet européen Odeuropa, mené par Inger Leemans et Cecilia Bembibre, s’est donné pour mission de préserver les odeurs historiques en associant intelligence artificielle et savoir-faire humain. Leur projet : restituer des trésors olfactifs disparus ou rares, et les proposer au public dans des musées comme le Rijksmuseum d’Amsterdam ou le musée d’Ulm. Les visiteurs y découvrent ainsi l’odeur de la bataille de Waterloo : un mélange de terre mouillée, de sueur et de poudre à canon. D’autres senteurs, comme celles des gants parfumés à la rose et au jasmin, font aussi revivre des fragments de l’histoire.
Pour limiter l’apparition de mauvaises odeurs et protéger les livres, plusieurs techniques existent et sont régulièrement utilisées :
- L’usage de bicarbonate de soude ou de talc pour absorber l’excès d’humidité.
- L’application de fécule de maïs pour neutraliser certaines effluves persistantes.
- L’ajout de gel de silice ou l’installation d’un déshumidificateur pour maintenir un environnement stable.
La diversité olfactive d’une bibliothèque dépasse la simple liste de ses ouvrages : elle devient une mémoire vivante, où chaque livre raconte le passé à travers son parfum, invitant à redécouvrir l’histoire du bout du nez.